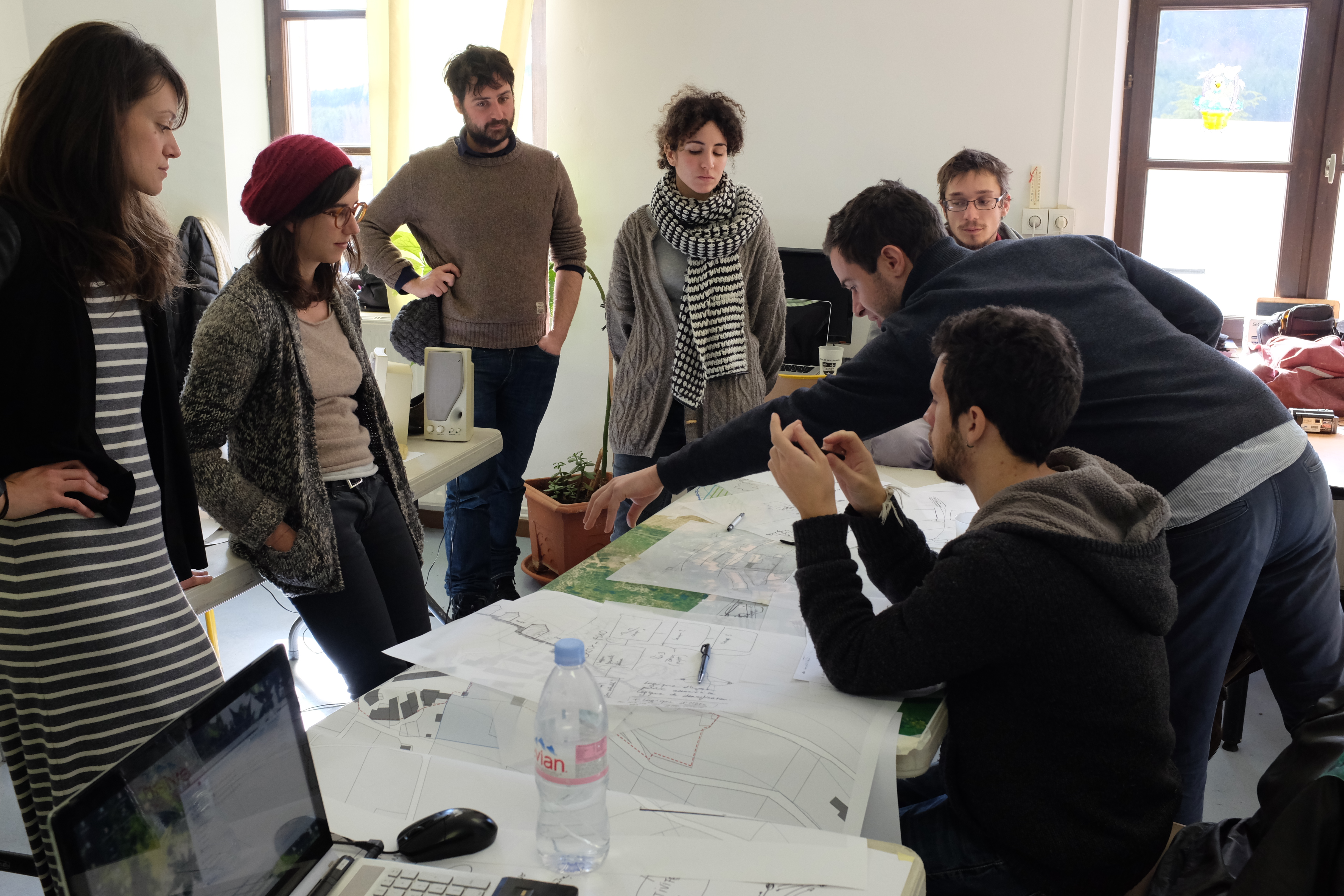“Pour que le caractère d’un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l’idée qui la dirige est d’une générosité sans exemple, s’il est absolument certain qu’elle n’a cherché de récompense nulle part et qu’au surplus elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d’erreurs, devant un caractère inoubliable.”
JEAN GIONO, L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES, ÉDITIONS GALLIMARD, 1983
Dans ce texte universel, remplacer les mots “être humain” par “architecte”, ça fonctionne. Remplacer “être humain” par “projet”, ça fonctionne encore…
En 2022, le nouvel Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires accueillera sur le site de la Porte d’Aix les actuelles École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSA•M),
Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-en-Provence (IUAR) et antenne marseillaise de l’École Nationale Supérieure du Paysage (ENSP).
Euromed et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille ont conjointement décidé, dans la suite des actions de l’association Synapse, de préfigurer la présence de ces écoles dans le
quartier, sous forme d’un pavillon d’une centaine de mètres carrés.
A la demande de Jean-Marc Zuretti, nous avons accepté d’en faire le projet du premier semestre de Master du LAB43 : “Pas d’Architecture Sans Structure”, sous forme d’un atelier intensif
de 3 mois, ponctué de 3 Workshops avec restitution publique, sur les thèmes : Site & Usages, Processus & Matérialités et Détails.
En Septembre nous avons donc accueilli un groupe de 27 étudiants, riche de diversité, inscrits et motivés par l’objectif et la démarche de notre atelier, dont les trois clés d’entrée étaient
les suivantes :
- La posture du département LAB43 :
Fabriquer une architecture chargée de sens et d’émotion, de raison, d’impertinence et de plaisir.
Trouver une adéquation entre un contexte social et une vision onirique qui révèle un site ou une situation.
Faire confiance à la liberté d’expérimenter, chercher, comprendre, rêver pour atteindre une évidence, en acceptant les moments d’égarement de tout processus créatif.
- Les fondements du programme “Pas d’Architecture Sans Structure” 1
Inverser le mécanisme traditionnel de conception, qui s’appuie sur la synthèse des contraintes de tout ordre, pour faire du projet à partir d’un seul de ses ingrédients, la structure, sans toutefois lui être exclusivement soumis.
Se forger une pensée constructive ancrée dans le réel, en partant du postulat que la structure des édifices est la matière construite du projet garante de pérennité.
Imposer une réflexion sur la dimension temporelle et patrimoniale de l’architecture en anticipant sur la reconversion d’usage de toute construction.
- Et bien sûr, la commande initiale, concrète de l’École d’Architecture et Euroméditerranée pour la construction In Situ d’un pavillon préfiguratif de l’IMVT, en capacité d’accueillir des
expositions, conférences, associations, voire réunions de chantier.
Cette année, les étudiants étaient saisis d’un programme atypique, situé dans le quartier de la Porte d’Aix à Marseille. Il s’agissait d’une part de concevoir un pavillon préfiguratif clos et couvert du futur Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) qui sera livré in situ en 2022 et qui réunira en son sein l’antenne marseillaise de l’École Nationale Supérieure du Paysage (ENSP), l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix- en-Provence (IUAR) et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSA- M). La Maitrise d’Ouvrage du pavillon est assurée par cette dernière et sa mise en œuvre est programmée au premier semestre 2018.
Les étudiants devaient réfléchir d’autre part à la programmation et aux principes architecturaux d’un bâtiment situé sur l’îlot Pelletan et dont la Maitrise d’Ouvrage est assurée par l’Établissement Public Euroméditerranée. Ce dernier a élargi sa demande de réflexion sur la réactivation des nombreux rez-de-chaussée neufs et existants vacants dans le quartier.
1er temps
Site & usages
Unité d’action, unité de temps, unité de lieu
De nombreuses rencontres ont ponctuées le premier temps consacré à la compréhension du quartier de la Porte d’Aix, à son histoire et aux enjeux de la création de l’IMVT.
Il y a eu celles organisées dans le cadre de l’exercice, et en premier lieu une rencontre inter- écoles pour que les étudiants en paysage, en urbanisme et en architecture fassent connaissance et puissent travailler ensemble sur le pavillon préfiguratif, à l’image de ce que pourra être un exercice pédagogique partagé au sein de l’IMVT.
Il y a eu aussi celles plus spontanées, improvisées sur place lors des visites collégiales de site ou par les étudiants eux- mêmes qui sont allés par petits groupes à la rencontre des acteurs du quartier : les habitants, les commerçants, les institutionnels et le tissu associatif.
Ces rencontres et ces enquêtes de terrain ont fait comprendre aux étudiants qu’un pavillon préfiguratif décontextualisé et peu ouvert sur le quartier serait sans doute perçu par les habitants de la Porte d’Aix comme une « terra incognita » à usage quasi exclusif des étudiants, alors que l’enjeu réel du projet était de créer du lien entre les différents acteurs déjà en place – particuliers et institutionnels – mais aussi avec ceux à venir – le milliers d’étudiants qui allaient investir les lieux à l’horizon 2022 – dans une relation fondée sur la compréhension et l’estime de l’autre.
Il était donc fondamental que le pavillon soit une terre d’accueil pour tous les publics et qu’il soit avant tout un outil pédagogique, d’une part pour mieux faire comprendre aux habitants leur quartier et ses mutations successives et d’autre part pour leur expliquer la vocation de l’IMVT et des métiers qu’il enseignera.
Tout au long du semestre, le besoin d’ancrage social du pavillon dans le quartier a amplifié la question de son rapport au sol, déjà présente avec l’interdiction de fonder mécaniquement un projet éphémère sur l’espace public.
Les étudiants ont sentis que les outils programmatiques dont ils disposaient ne permettraient pas une action suffisamment large pour assurer du lien avec les habitants et l’ancrage progressif de l’IMVT dans le quartier tant ces outils étaient par nature étanches entre eux et diffus sur le territoire.
La réflexion sur l’îlot Pelletan commandée par Euroméditerranée permettait certes de proposer des programmes accueillant des activités utiles au quartier et à ses futurs
étudiants mais elle était trop précisément située le long du futur parc, fermé la nuit, pour permettre une suture sociale efficace entre les habitants de l’Ouest, le long de l’avenue Pelletan et ceux de l’Est, dans la résidence Le Turenne leur faisant face, trop longtemps séparés entre eux par l’autoroute A7 et sa cicatrice actuelle.
La réflexion sur la vacance des rez-de-chaussée, également commandée par Euroméditerranée, était pertinente mais les rez-de-chaussée concernés étaient trop diffus et leurs statuts juridiques trop variés pour pouvoir proposer un ensemble de programmes réalistes et cohérents entre eux, capables de les occuper pleinement.
Quant au pavillon, sa petite dimension contrastait avec l’échelle de l’espace public déjà construit ce qui rendait son attache au site difficile et son isolement certain. Sa relative faible amplitude horaire d’ouverture associée à la demande d’un pavillon clos et couvert risquait également de le rendre trop étanche à l’espace public, lui faisant perdre par la- même sa vocation première d’accueil…
La proposition des étudiants jardiniers urbains
Au début de semestre, Aline BURLE, architecte et membre de l’association SYNAPSE Marseille qui avait été à l’initiative de propositions pour investir le quartier de la porte d’Aix avant l’arrivée de l’IMVT, est venue présenter son Projet de Fin d’Étude (PFE) portant sur cette thématique.
Celui- ci a sans doute été inspirant pour les étudiants car c’est alors que, à l’image de l’action menée par le berger Elzéard Bouffier dans l’homme qui plantait des arbres dans le roman éponyme de Jean GIONO[2], ils ont proposé une action dans la durée en ponctuant les 5 ans d’attente de la migration des 3 écoles constituants l’IMVT d’une succession d’interventions, incluant les demandes du programme initial mais en les reformulant quelque peu et en les adossant à des programmes complémentaires de type événementiel inspirés par un travail préliminaire de référencement d’interventions d’artistes et d’architectes sur l’espace public.
Multi- scalaires et de temporalités variées, ces interventions sont comme autant d’arbres plantés qui permettront d’investir en douceur et progressivement le quartier en cultivant le terreau fertile des liens sociaux à fortifier.
C’est précisément à ce moment- là que le projet a pris son envol.
Au lieu d’être une succession de beaux objets finis, étanches entre eux et avec l’espace public, telle que la production de la ville le fabrique souvent aujourd’hui, le projet est avant tout un processus d’accompagnement de la mutation du quartier qui intègre la valeur du temps – même s’il n’est question ici que de quelques années – nécessaire au germe de la planification urbaine mise en place par Euroméditerranée et la Ville. Après tout, la ville méditerranéenne n’est- elle pas constituée d’une stratification de mouvements migratoires que le temps aide à fixer ?
L’ENSA•M ayant débloqué un budget en fond propre pour la construction du pavillon préfiguratif, il était entendu que les étudiants devraient trouver des partenariats extérieurs pour mettre en œuvre leurs propositions complémentaires au programme initial de l’exercice.
Un évènement inaugural
Le bankimank
Pour illustrer leur démarche, les étudiants ont proposé rapidement un évènement inaugural consistant à mettre en œuvre au premier semestre 2018 un escalier provisoire enlaçant l’Arc de triomphe qui ponctue l’axe urbain historique Nord/ Sud de Marseille.
Réalisé en structure d’échafaudage, il permet d’accéder à une plateforme haute depuis laquelle les habitants et les futurs étudiants pourront regarder ensemble le quartier d’un point de vue inédit et découvrir sa mutation grâce à une table d’orientation expliquant les interventions et les projets à venir d’Euroméditerranée et des étudiants, jusqu’à l’arrivée de l’IMVT.
Face au constat d’absence de banc sur l’espace public fraîchement requalifié, les étudiants ont appelé l’escalier provisoire le Bankimank, autrement dit le « banc qui manque » puisqu’il pourrait aussi servir d’assises aux habitants.
D’un point de vue opérationnel, le projet pourrait être porté par l’association Synapse Marseille dans laquelle les étudiants ont l’intention de s’investir pour s’assurer de la réussite de leurs propositions. Il pourrait être financé par des entreprises spécialisées en montage de structures événementielles.
2ème temps
Manipulations structurelles
En octobre, le deuxième temps a été consacré aux manipulations structurelles avec une approche de la structure par la maquette.
Les étudiants devaient proposer un ou plusieurs éléments de structure combinés entre eux, capable de répondre au programme du pavillon préfiguratif. Ces propositions devaient être portées par une réflexion sur le processus de mise en œuvre incluant la question de la matière première et de son ré- emploi en fin de vie du pavillon.
Les éléments constituants la structure et l’enveloppe assurant le clos et le couvert devaient pouvoir se transporter, s’assembler et se monter facilement sans avoir recours à des moyens de levage complexe et onéreux.
C’est alors que les ingénieurs encadrants ont fait leur entrée dans le semestre, et notamment Marine Bagneris, membre du laboratoire de recherche MAP GAMSAU-CNRS, tournée plus précisément sur la question de la pierre, puisqu’un des enjeux du semestre était de créer un lien entre enseignement du projet et recherche.
Romain Ricciotti a apporté aux étudiants son expertise du béton et Nobouko Nansenet, architecte, celle de la pierre et du bois, forte de ses 7 années passées auprès de Gilles Perraudin en tant que chef de projet.
Deux sorties pédagogiques ont nourri la réflexion sur la matière structurelle : la première sur le thème de la pierre a fait découvrir aux étudiants le monde des carriers et le chais de Vauvert dont son architecte, Gilles Perraudin leur en a expliqué la genèse, et la seconde sur le thème du béton avec la visite d’une usine de préfabrication et des chantiers de bâtiments et d’infrastructures intégrant des ouvrages en béton ultra haute performance.
Au départ, les manipulations structurelles ne se sont pas embarrassées de question de site, ni de forme ni d’enveloppe pour que puissent en naître les structures les plus singulières possible. La seule contrainte était de former un espace suffisamment grand pour accueillir tout ou partie des usages du programme.
Assez rapidement, les étudiants se sont heurtés au choix d’une architecture standard ou non- standard, et par corollaire, à la question de l’enveloppe et de son rapport à la structure puisque le pavillon devait être clos et couvert, c’est à dire être étanche à l’eau et à l’air sans qu’il soit toutefois question d’aller jusqu’à en obtenir une valeur réglementaire.
C’est face à ces complexités, qui se seraient retrouvée dans la mise en œuvre du pavillon retenu, ainsi que face à celle de la mise en œuvre des commodités nécessaires à l’accueil du public que les étudiants ont proposé de fractionner en deux le programme initial du pavillon. La première partie serait une base vie située dans un des rez-de-chaussée vacant et qui accueillerait ces commodités et du stockage de matériel facile à sécuriser. La seconde partie serait une structure située sur l’espace public, libérée partiellement de ses contraintes thermiques, et pour y accueillir des manifestations aussi variées qu’un cours public d’architecture, d’urbanisme ou de paysage, une conférence, des projections de films, des concerts, des expositions, etc. Hors manifestations, cette structure offrirait au public un abri, de l’ombre et parfois un banc.
Fin octobre, les étudiants ont soumis au comité de suivi pas moins de 9 propositions différentes de pavillons accompagnées d’une réflexion sur la programmation de l’ilôt Pelletan et sur l’occupation des rez-de-chaussée vacants dont la base vie faisait maintenant partie, parmi des programmes à usages partagés inédits tels qu’un washbar, des ateliers publics de réparation, une bibliothèque partagée, etc., autant d’usages concrets et utiles à la vie du quartier et de ses futurs étudiants.
Pour accompagner l’implantation de l’IMVT et à la suite du Bankimank, les étudiants ont également proposés une série d’actions sur l’espace public, cette fois- ci menées par des artistes issus du street- art ou de l’univers du cirque, et dont la vocation était de révéler le lieu en utilisant des outils communs avec ceux des architectes. Une de ces interventions consiste à faire interagir l’artiste Yohan Le Guillerm avec l’espace public de la porte d’Aix grâce à un de ses spectacles de rue intitulé la Transumante, consistant à manipuler une structure tridimensionnelle dans le but de la faire se déplacer comme un organisme vivant, grâce à la permutation successive de ses petits éléments de bois la constituant.
L’expertise du comité de suivi et des encadrants a conclu à ce stade que les 9 propositions de pavillons n’étaient pas toutes viables, soit parce qu’elles présentaient des structures dont la conception ou la mise en œuvre seraient trop complexes, soit parce qu’elles ne garantissaient pas la pérennité nécessaire à un petit édifice confronté à l’espace public, soit parce qu’il serait difficile de les faire rentrer dans le budget prévu à cet effet.
Il a été alors proposé et décidé collégialement de répartir les 9 propositions de pavillons dans 2 catégories distinctes :
- Les structures expérimentales, jugées insuffisamment pérennes mais ayant tout de même un intérêt, soit pour animer temporairement le quartier, soit pour nourrir la recherche sur les structures dirigée par Marine Bagnéris et qui pourraient être développées ultérieurement dans le cadre de son laboratoire. Un projet de balises urbaines ponctuant le quartier, provenant de la fragmentation d’une des 9 propositions de pavillon a été également classé dans les structures expérimentales.
- Les pavillons dont certains ont été regroupés deux à deux pour n’en retenir que 4, tant les thématiques structurelles qu’ils proposaient étaient
Fin octobre, les étudiants se sont retrouvés à devoir traiter 5 types de projets au cours des deux derniers mois du semestre :
- Les évènements constitués du Bankimank et de la Transumante
- La réflexion sur la programmation et les principes architecturaux de l’ilot Camille Pelletan.
- La réflexion sur l’activation sur les rez-de-chaussée.
- Les 4 pavillons préfiguratifs.
- Les structures expérimentales.
Les groupes ont été alors reconstitués pour les équilibrer en tenant compte de la nouvelle configuration des projets.
3ème temps
Détails constructifs
Le rapport au sol et le plancher haut – le toit – ont été tout au long du semestre les deux écueils constructifs sur lesquels les étudiants ont longtemps butés, tout comme la prise en compte des contraintes de mise en œuvre de certaines matières comme les assemblages d’éléments en bois ou le harpage des murs en pierre leur assurant la stabilité au séisme. Ce 3ème temps était donc consacré à la mise au point technique des pavillons, toujours suivie de près par les ingénieurs. Les étudiants sont allés aussi à la rencontre d’un charpentier pour avoir un retour opérationnel concret sur leurs projets.
Très vite, de grandes familles d’éléments de structure ont vu le jour, nourries par les séminaires des 3 dernières années mis à disposition des étudiants.
Il y a eu d’un côté les structures légères, faites d’assemblage d’éléments en bois, principalement des portiques et des béquilles, qu’il fallait lester faute de fondation. La technique du plancher caisson a été une opportunité de ce point de vue car elle permettait à la fois de remplir ses alvéoles de sacs de sable, tout en proposant des usages en creux du fait de leur épaisseur d’une quarantaine de centimètres (bancs, fosse de concert, fosses de plantation, etc.)
De l’autre côté, les structures lourdes, faites d’assemblage de pierres étaient lestées de fait. L’enjeu de ces structures était plutôt d’ordre économique puisque cette matière reste onéreuse notamment à la taille. L’utilisation de pierres brutes d’extraction mais surtout, le partenariat développé avec la société Carrières de Provence visitée en octobre a rendu possible ces projets en travaillant sur la notion de prêt de matière, inédit jusque-là pour ce matériau. En fin de vie du pavillon, les pierres seraient rendues à la carrière pour une seconde vie, seul le transport, le levage et la mise en œuvre restant à la charge de l’école.
Côté toiture, les questionnements furent multiples…
D’un point de vue structurel, les étudiants ont convoqué la – relative – grande portée et le porte- à- faux dans leurs projets, ce qui était pertinent d’un point de vue de l’usage aussi bien pour obtenir une liberté d’usage à l’intérieur des pavillons que pour ombrager l’espace public. L’efficacité des toitures caissons bois s’est avérée redoutable pour la plupart d’entre eux et cette technique s’est retrouvée employée tout autant dans les structures légères que dans les structures lourdes. Outre son avantage de minimiser les points porteurs, elle génère des creux en sous- face exploitable pour traiter l’acoustique ou l’éclairage.
Un groupe a travaillé sur le franchissement en s’adossant à l’expérience de Marine Bagnéris sur les poutres en pierres précontraintes développée dans le cadre de son laboratoire de recherche avec les carriers et les compagnons du devoir. L’abandon d’une enveloppe thermique au profit d’une simple enveloppe « protectrice » a permit également de minimiser la multiplication des couches de matière puisque l’isolation thermique pouvait être compensée en grande partie par la ventilation naturelle, à l’image de l’architecture tropicale.
Restait la question de l’étanchéité, ou là encore, grâce à l’utilisation d’une base- vie mettant à l’abri le matériel sensible, des solutions simples et efficaces ont pu être employées sans avoir recours à la mise en œuvre de couches multiples et onéreuses : couverture sèche simple peau, étanchéité bitumineuse passée au rouleau, membrane- vélum étanche permettant de filtrer par la même occasion la lumière à l’intérieur, etc.
Le travail sur le contreventement des pavillons a quant à lui nourrit la réflexion sur la forme et l’usage puisque c’était soit la forme du pavillon qui en assurait la charge, soit la disposition de palées de stabilité, au droit de l’enveloppe ou en partitionnement d’espaces intérieurs.
En fin de semestre, les étudiants sont parvenus à dessiner les pavillons au 1/ 20ème en s’assurant de leur réalisme constructif, de la pertinence de leur processus de mise en œuvre, de leur pérennité dans l’espace public et de leur ré- emploi. Sur ce dernier point, certains étudiants ont proposés de réutiliser tout ou partie de leur proposition, que ce soit en restituant les pierres aux carriers pour un autre projet, en démontant et remontant les gloriettes du parc ailleurs ou en utilisant les toitures caissons pour couvrir les nouveaux espaces sportifs extérieurs du centre social Velten limitrophe.
Et après ?
Le jury de fin de semestre a réuni les principaux acteurs du projet, l’Établissement public Euroméditerranée, l’école du paysage et l’IUAR, et bien sur la direction et un représentant du conseil d’administration de l’école d’architecture de Marseille.
Tous ont salués l’engagement des étudiants face à une situation concrète de projet et tous ont salués l’engagement du projet face à une situation urbaine en attente de la formalisation de son devenir.
L’histoire est écrite, il reste à la mettre en œuvre, tout d’abord en choisissant un pavillon préfiguratif parmi les 4 proposés, puis en activant les autres propositions par le biais des différents intervenants et outils mis en place au cours du semestre. C’est le travail à accomplir au premier trimestre 2018. L’engagement total des étudiants dans l’association Synapse fin 2017 ne peut que nous convaincre de sa réussite.
Casting du semestre
Les étudiants
- A Waël ABUISSA, Estelle ALBRAND ;
- B Antoine BAGATTINI, Alexis BARRET, Loïc BELLET, Adel BENNOUI, Ryan BENTABAK, Fernanda BLANC, Camille BOBEAU, Cynthia BONNEFILE, Clémence BROC ;
- C-E Fadhel CHÉRIF, Chloé COTTREAU, Maxime ELICKI ;
- G Claire GARDAN, Hugo GILBERT, Alexandre GUILLALMON ;
- L-M Clément LABAT, Lucas LAFOUX, Erwan LE PANCE, Monika MOLIK ;
- O-P Caroline ORDENER, Chloé OTTO- BRUC, Sarah PATTERI, Kévin PONCE ;
- S-T Arthur SANCHEZ Roxane TROIA.
Les encadrants
- Kristell FILOTICO, architecte, enseignante TPCAU ;
- Jerôme APACK, architecte, enseignant TPCAU, responsable du S7LAB ;
- Marine BAGNERIS, ingénieur, enseignante STA, membre du laboratoire MAP GAMSAU – CNRS ;
- Jean-Marc HUEBER, ingénieur, enseignant STA, technologie des enveloppes et des ambiances ;
- Thomas VAN GAVER, architecte, enseignant vacataire ;
- Romain RICCIOTTI, ingénieur, bureau d’étude structure LAMOUREUX & RICCIOTTI Nobouko NANSENET, architecte, chef de projet de Gilles PERRAUDIN ;
- Aline BURLE, architecte, membre de l’association Synapse.
Les intervenants extérieurs dans l’ordre de leur apparition dans le semestre
- Nicolas MATTEÏ, Établissement public Euroméditerranée, chargé d’opération de la ZAC Saint Charles ;
- Jean- Michel SAVIGNAT, architecte, urbaniste de la ZAC Saint Charles ;
- Thierry CICCIONE, architecte, agence d’urbanisme STOA, Maître d’Œuvre des espaces publics de la ZAC ;
- Rosy XIBERRAS, directrice du centre social Velten- Bernard Dubois Nicolas MÉMAIN, montreur d’ours urbains ;
- Jérôme MAZAS, paysagiste, enseignant à l’École du paysage de Marseille. Étienne BALLAN, sociologue, enseignant à l’École du paysage de Marseille ;
- Nicolas LUTTRINGER, directeur de la société de préfabrication d’ouvrages en béton Bronzo- Perrasso ;
- Sylvain JUANOLA, entreprise Fondeville ;
- Paul MARIOTTA, directeur de la société Carrières de Provence à Vers-Pont-du-Gard Erwan QUEFFELEC, ingénieur, bureau d’études I2 C ;
- Ronan KERDREUX, designer, professeur de design, École Supérieure d’Art et de Design de Marseille ;
- Hélène CORSET, chef de service, architecte des Bâtiments de France, chargée du secteur de Marseille ;
- Claude MOREL, charpentier, directeur des Établissements MOREL ;
- Hugues PARANT, directeur général de l’Établissement Public Euroméditerranée ;
- XXX, de l’École du paysage ;
- YYY, de l’IUAR.
Les enseignants du LAB43
- Anne-Valérie GASC, artiste, enseignante chercheur AR ;
- Muriel GIRARD, sociologue, enseignante chercheur SHS ;
- Mariusz GRYGIELEWICZ, artiste, enseignant AR ;
- Matthieu POITEVIN, architecte, enseignant TPCAU ;
- Rémy MARCIANO, architecte, enseignant TPCAU ;
- José MORALÈS, architecte, enseignant TPCAU.
Et les enseignants de l’école d’architecture de Marseille qui sont passés voir les travaux des étudiants et ont assisté aux restitutions mensuelles.
Le projet des étudiants
-
Les évènements
- Le Bankimank
Waël ABUISSA, Cynthia BONNE ÎLE, Maxime ELICKI, Claire GARDAN, Arthur SANCHEZ
- La Transumante
Johann LE GUILLERM, artiste circassien http:// www. johannleguillerm. com/
-
Programmation et intentions architecturales pour l’ilot Pelletan
Fernanda BLANC, Clément LABAT, Chloé OTTO- BRUC
-
Les rez-de-chaussée
Camille BOBEAU, Clémence BROC, Chloé COTTREAU, Monika MOLIK
-
Les pavillons
- Corps lumineux
Waël ABUISSA, Cynthia BONNEFILE , Maxime ELICKI, Claire GARDAN, Arthur SANCHEZ
- L’agora
Löic BELLET, Alexandre GUILLALMON
- La cour
Alexis BARRET, Hugo GILBERT, Lucas LAFOUX
- Un toit pour toi
Fadhel CHÉRIF, Caroline ORDENER
-
Les structures expériementales
- Balises urbaines
Estelle ALBRAND, Sarah PATTERI
- Les gloriettes de Saint Charles
Adel BENNOUI, Ryan BENTABAK, Kévin PONCE, Roxane TROIA
- L’ornithogale
Antoine BAGATTINI, Erwan LE PANCE
- Les voutes « 2 secondes »
Hugo GILBERT, Alexis BARRET
https://lab43s7.tumblr.com/
[1]L’intitulé « Pas d’architecture sans structure ! » emprunté à Mario Salvadori dans son ouvrage « Comment ça tient ? » aux éditions Parenthèses
[2] L’homme qui plantait des arbres, Jean GIONO, Éditions Gallimard, 1983. Dans cette fiction universelle, le berger Elzéard Bouffier passa sa vie à planter des arbres dans un coin aride des Alpes de Haute Provence pour en faire la terre d’accueil de nouvelles familles dans l’espoir de réactiver cette campagne sinon promise à la désertification.