Dessiner les limites de la grande ville
Au début du XXe siècle, Paris demeure assurément la grande référence en matière d’Art urbain, tant pour la qualité de son réseau d’espaces publics que pour l’excellence du savoir-faire que prodigue la section architecture de son École des Beaux-Arts (Lortie, 1995). Pour autant, la suite se joue déjà ailleurs. En effet, alors que la capitale française peine à s’affranchir de sa dernière enceinte, la plupart des grandes villes du monde industrialisé s’inquiètent d’intégrer des périphéries dont la croissance interroge leur propre centralité. Le plus souvent dans le cadre de consultations internationales, elles envisagent leur avenir sur des territoires de plus en plus vastes, dans le cadre de programmes de plus en plus complexes. Et si la culture classique française continue à s’exporter, son interprétation, sur d’autres terrains, à d’autres échelles, s’accompagne de la reconnaissance d’autres approches, comme celle de la cité-jardin, d’autres références, comme celle du park system, et d’autres savoir-faire, comme celui développé de longue date par les concepteurs et les techniciens allemands. En prélude et en écho à ces moments de synthèse que constituent les manifestations organisées à Berlin et à Londres, toute une génération de concours, d’expositions et de congrès, relayée par des publications, témoigne, au-delà d’un panorama de situations singulières, de la genèse d’une pensée « urbaniste », qui se spécialise et s’internationalise, interrogeant l’identité générique de la grande ville moderne, ses modes de production et de gouvernance, mais aussi le devenir de ses limites dans un cadre territorial. Pour explorer les apports en la matière d’un mouvement foisonnant, nous partirons de trois thèmes majeurs associés à leurs terrains de référence, la grande composition, qui défend le principe d’une vision unitaire de la ville notamment dans le cadre des concours, le concept de cité-jardin, qui se veut une alternative radicale à l’expansion continue de la métropole londonienne, et l’idée même de la grande ville, qui devient une ambition allemande et berlinoise.
De Barcelone à Canberra via Chicago : la grande composition à l’épreuve du territoire
Telle une marque de fabrique, la grande composition semble intimement liée à la formation délivrée par l’École des Beaux-Arts de Paris et plus particulièrement au concours du Grand Prix de Rome dont les lauréats sont rompus à cette approche du projet, unitaire et hiérarchisée, alimentée par un grand répertoire[1]. Cette méthode parait infaillible pour aborder les terrains et les programmes les plus complexes, parmi lesquels s’impose alors la figure de la grande ville. Que ce soit sous la forme de concours ou de commandes directes, les premières années du XXe siècle voit se multiplier des programmes visant aussi bien la définition même de cette grande ville, la fondation de villes nouvelles que la recomposition de capitales existantes. Parmi les situations investies par les tenants de la grande composition, trois les ont plus particulièrement obligés à se poser la question des limites. Signe des temps, après s’être imposée « naturellement » à Barcelone et à Chicago, l’école parisienne s‘incline en terra incognita, à Canberra.
Barcelone : composer avec la trame de Cerda et le grand paysage
En 1903, Barcelone lance un concours international pour la conception d’un plan d’aménagement visant à articuler les communes limitrophes à sa propre extension, l’ensanche conçue 50 ans plus tôt par lldefonso Cerda. À l’origine de cette consultation, l’annexion en 1897 de six de ces communes alors en pleine croissance démographique et économique. Forte désormais de près de 8 000 hectares et de plus de 500 000 habitants, la plus grande ville industrielle d’Espagne rejoint Paris, en terme de surface, et Madrid, en terme de population Ce réajustement territorial s’accompagne de l’arrivée au pouvoir d’une élite réformiste et régionaliste dans les rangs de laquelle l’architecte Puig y Gadafalch, farouche détracteur de l’ensanche, milite pour une recomposition de la capitale catalane dans l’esprit du Paris haussmannien (Gondouin, 2004). Le seul envoi qui réponde pleinement à ces attentes révèle en 1905 un jeune architecte français d’origine toulousaine, récent Grand Prix de Rome et pensionnaire de la villa Médicis, Léon Jaussely[2]. La mise au point particulièrement fouillée que ce dernier finalise en 1907 après un court séjour sur place est également l’occasion d’un ambitieux mémoire (Jaussely, 1907). Si le nouveau maître des lieux y reconnaît la force et l’efficacité de la grille de Cerda, il en critique l’uniformité qu’il propose de réformer en s’appuyant tout à la fois sur le milieu et de multiples références où se mêle aussi bien l’expérience allemande, à laquelle il emprunte le principe du zoning, que sa propre culture, parisienne, illustrée par le recours à des logiques radioconcentriques, ou catalane. De manière significative, le texte, rédigé en espagnol, utilise la terminologie locale ; ici pas de boulevards ou de radiales donc, mais des paseos et des diagonales que l’on retrouve au sein d’une armature viaire, le squelette, dont la complexité requiert un regard informé[3].
Dans l’écheveau viaire que met en scène le rendu du concours, un premier regard identifie d’emblée l’épicentre monumental de la composition, à savoir la place des gloires Catalanes dont l’étoile systématise la croisée des deux diagonales originelles[4]. S’impose également la volonté d’encadrer et de hiérarchiser la grille de l’ensanche, à partir de la gestion des flux, par une trame première plus large. En revanche, la compréhension des tracés qui articulent ces deux systèmes élémentaires suppose d’entrer plus avant dans le projet dont deux schémas livrent les clefs[5]. L’un concerne un modèle théorique global, et l’autre, les seules grandes voies de circulation. Le premier illustre une ville moderne étagée dans la pente, entre mer et montagne, avec en première ligne la ville de l’industrie et celle du commerce, et en second rang celle des habitations, le tout inscrit dans une grille recoupée, en son centre, par deux diagonales majeures, et sur les côtés, par des diagonales mineures qualifiées de circonvallation[6]. Le second met en scène les deux diagonales majeures et l’ensemble des voies susceptibles de participer à un contournement, en soulignant le parcours dans ce réseau primaire d’une circonvallacio industriale qui dessert les zones industrielles dont le port. Dans l’un comme dans l’autre, il n’y a donc pas de voie ayant pour seule fonction d’assurer le contournement de la ville. De ce point de vue, le paseo del ronda, qui relie les communes annexées au pied des reliefs du massif de la Collserola peut être considéré aussi bien comme une traverse intermédiaire, parallèle à la Gran via, que comme le fragment d’un boulevard de ceinture. Par ailleurs, dans sa mise au point du rendu du concours[7], Jaussely développe en profondeur le principe de ces voies parallèles, en investissant graduellement le massif avec un paseo rural surmonté d’un paseo mediano et d’un paseo alto qui desservent successivement une zona rural et les premières pentes boisées. Ainsi, la proposition de Jaussely peut-elle se lire comme une réinterprétation globale de l’ensanche qui vise à déconstruire l’hétérotopie de la grille originelle pour créer un nouveau maillage mieux articulé avec le cadre naturel de la nouvelle agglomération.
Chicago : transcender une trame territoriale
De l’autre côté de l’Atlantique, tout commence avec la rencontre de Daniel Burnham et de Frederick Law Olmsted autour de la préparation de l’exposition colombienne de 1893 (Roche, 2009). Ces deux grands interprètes de l’héritage haussmannien inventent de concert une ville analogue, la ville blanche, dont le paysage et les tracés font rêver l’élite réformiste américaine. De Washington à Cleveland, une série de projets d’embellissement dessine un City beautiful movement qui permet à Burnham de faire ses classes en tant que city maker. Dans le même temps, à Chicago, il défend le principe d’un parc linéaire longeant les rives du Lac Michigan auprès d’une association d’entrepreneurs et d’hommes d’affaires, laquelle le relance bientôt pour élargir cette vision à l’ensemble d’une ville au bord du chaos. Capitale économique des Etats-Unis, Chicago est alors en passe d’atteindre les 2 millions d’habitants dans le cadre d’une croissance qui lui en promet plus de dix, dans les décennies à venir. Six terminaux de chemin de fer, un port et une multitude d’usines et d’entrepôts y génèrent des problèmes de flux, de pollution et de cohabitation sociale qui, devenus incontrôlables, menacent la prospérité de la ville. Si l’hyper densité du centre y appelle le déploiement d’une ville verticale, l’ampleur du développement attendu conduit à la prise en compte d’un territoire le plus large possible. Par ailleurs, l’origine privée du projet lui impose une forme d’efficacité démonstrative immédiate (Castex, 2010). Pour répondre à ces multiples enjeux, le plan de Chicago élaboré sous la direction de Burnham entre 1906 et 1909, met en avant un schéma radioconcentrique élémentaire dont la déclinaison spatiale s’appuie en premier lieu sur le modèle parisien, une valeur sûre en termes de références et de savoir-faire que réactualise à point nommé les Études sur les transformations de Paris d’Eugène Hénard (Draper, 1987)[8].
Si les célèbres aquarelles de Jules Guérin désignent incontestablement l’aménagement des rives du Lac Michigan comme la pièce maîtresse du projet, la place du nouveau capitole y apparaît tout aussi clairement comme le point focal d’une composition centralisatrice d’échelle métropolitaine. Ce parti fondateur se développe en étoile dans un rayon d’environ 100 kilomètres, maillé par deux séries de voies concentriques recomposées, quatre grandes routes de ceinture à l’échelle territoriale, et quatre contournements à l’échelle urbaine. Entre ces deux séries s’impose une figure singulière, dite du grand circuit[9] ; partiellement circulaire, d’environ 5 kilomètres de rayon et d’une quarantaine pour son périmètre, elle délimite la partie la plus urbanisée de l’agglomération et joue le double rôle de contournement et de ceinture verte. Son tracé englobant permet d’articuler l’ensemble des voies radiales partant du centre, tandis que sa largeur, d’environ 120 mètres, permet d’y développer des espaces de « respiration » qui font le lien entre trois nouveaux parcs. Mais, ce grand parkway périphérique entend également incarner l’esprit de ces boulevards de ceinture propres aux villes européennes, que l’absence de fortifications semblait interdire à Chicago. Cette dimension symbolique est d’autant plus forte qu’à l’intérieur de cette figure, le dessin des autres contournements projetés repose sur l’ouverture d’une trentaine de diagonales à négocier avec une trame orthogonale fortement urbanisée. Au de là de cette nouvelle limite, le rapport insiste sur l’accompagnement végétal des grandes routes qui participent à l’accessibilité de forêts à protéger et à la structuration de campagnes à équiper. Étonnamment absent de la série des aquarelles de Guérin, le grand circuit est revanche au centre de la tout aussi remarquable série de cartes gigognes qui pose la question du cadre métropolitain. À la croisée du schéma et de la trame, de la ville dense et de la ville territoire, de la ville fluide et de la ville sociale rêvée par Burnham[10], le grand circuit apparaît ainsi comme une grande figure identitaire du plan de Chicago.
Canberra, du territoire au paysage
Aux antipodes de Barcelone et de Chicago, la future capitale de l’Australie semble également relever d’une tout autre ambition. La rivalité qui oppose Sydney à Melbourne au moment de l’indépendance en 1900 a en effet décidé d’emblée de la création d’une ville nouvelle dans le cadre d’une enclave territoriale inspirée par celle de Washington (Vernon, 2012). Situé au sud est de l’Australie à l’écart de l’océan, l’emplacement choisi en 1908 dans la vallée du Molonglo, symbolise l’identité pastorale revendiquée par le nouvel état, sous la forme d’un système collinaire mis en scène par une série de points hauts. Ce paysage devient l’argument premier d’un programme de concours qui engage les concurrents à en préserver le pittoresque, voire à l’accentuer par la mise en œuvre d’un plan d’eau[11]. La tenue de la Town planning conference (TPC) de Londres va permettre à l’architecte John Sulman, futur membre du jury, de défendre cette ambition paysagère et sa propre vision de la future capitale (Sulman, 1911). Entre autres recommandations, il écarte notamment la forme du boulevard qu’il juge inadaptée au mode de vie australien, mais aussi et surtout le principe des trames orthogonales auquel il oppose les mérites des tracés radioconcentriques, plus favorables à la circulation, jusqu’à proposer le dessin d’un noyau urbain rayonnant fondé sur une base octogonale. Publié dans les actes de la TPC, ce dessin va inspirer plus d’un des concurrents de cette compétition essentiellement anglo-saxonne, à commencer par les surprenants lauréats, Walter et Marion Griffin (Van Zanten, 1987). Leur réussite nous ramène de manière inattendue à la scène américaine et à Chicago même, mais cette fois du côté d’une autre vision du territoire, à l’opposé du monde parisien, celle de la Prairie School et de Frank Lloyd Wright dont ils furent les collaborateurs.
Le succès des Griffin repose en effet avant tout sur une prise de site remarquable qui superpose trois partis différents : une croisée majeure, entre la rivière et un axe monumental perpendiculaire dédié aux principaux équipements, une ossature d’axes, composée de deux faisceaux convergents vers les points hauts surplombant le site, et un réseau de huit noyaux urbains, basés sur une libre interprétation du modèle proposé par Sulman, traité ici comme un module de base. La synthèse donne l’image d’une ville polynucléaire, triangulée à la manière d’une structure cristalline, inscrite dans le grand paysage de la vallée, ancrée dans le site par une série de plans d’eau, et lovée entre ses multiples microreliefs par le jeu de nombreuses variations de trame. La cohérence formelle vient d’un effet de système et non d’une forme englobante : point de boulevard circulaire ou d’infrastructure périphérique, mais un traitement des limites qui opère une transition très graphique entre les tracés géométriques de la trame multidirectionnelle des différents noyaux, et ceux plus organiques reliant la frange de leurs tissus à la nature environnante. Pour autant, le projet ne renonce pas à la régularité d’une trame orthogonale qui reste dominante, jusqu’à éviter tout îlot triangulaire[12], pas plus qu’à la hiérarchisation des fonctions urbaines entre centre et périphérie, comme en témoigne, dans une première évolution du projet, la distinction opérée entre un triptyque central associant équipements et commerces, d’une série de noyaux satellites dédiés à l’habitat, à l’industrie ou plus étonnamment à l’agriculture. Quels qu’en soient les revers, ce parti novateur déqualifie alors la quasi-totalité des réponses des autres concurrents empêtrés dans une hiérarchisation classique, comme si le savoir-faire parisien, qui était parvenu à s’exprimer avec succès à Barcelone et à Chicago, avait trouvé, dans ce cadre et ce programme d’un tout autre monde, ses propres limites.
Autour de Londres : entre ville et campagne, la cité-jardin en catalyseur
En 1909, à l’heure de l’adoption du Town Planning Act (TPA) qui vise à donner aux villes anglaises les moyens de maîtriser leur extension à l’image des villes allemandes, le développement de Londres n’a toujours pas fait l’objet d’une véritable réflexion d’ensemble comme Barcelone, Chicago Vienne ou Berlin. Relancée un siècle plus tôt par la première vague d’urbanisation engendrée par une Révolution industrielle précoce, la croissance de la plus grande ville du monde semble alors devenue un processus incontrôlable. Ce sentiment d’impuissance n’est pas étranger à l’émergence du concept de cité jardin : cette vision refondatrice de la ville n’incarne t-elle pas le principe même d’une croissance urbaine maîtrisée ? Imaginée de manière radicale par Ebenezer Howard dès 1898, sur la base d’un projet social coopératif, ce nouvel idéal urbain acquiert rapidement une dimension universelle (Girard, 1996). Cependant l’interprétation qu’en propose Raymond Unwin à partir de 1904, dans le cadre d’une scène anglaise tiraillée entre ville et campagne, n’échappe pas longtemps à la question plus générale de l’extension des villes existantes et du traitement de leurs limites avec l’émergence du TPA. En témoigne, aussi bien Town planning in practice… [13], publié la même année, que les actes de la TPC (TPC, 1911), organisée par le RIBA, dans lesquels deux interventions esquissent les contours d’un Greater London en termes de boulevard périphérique et de villes nouvelles.
Howard, et le système de la cité-jardin
Garden cities of tomorow, la deuxième édition du texte de Howard, comporte 5 diagrammes ou figures schématiques dont trois formalisent le projet de la cité-jardin à différentes échelles[14]. En dépit de la célèbre formule qui les accompagne, A diagram only. Plan must depend upon site selected, ces figures font davantage qu’illustrer la pensée de Howard, elles révèlent, au delà des dispositifs spatiaux d’une cité-jardin type, toute la dimension territoriale de son projet. Cette échelle apparaît vers la fin de l’ouvrage, après que l’auteur ait précisé qu’une fois atteint le seuil des 32 000 habitants, il conviendrait d’établir à faible distance « une autre ville » sur les mêmes bases, jusqu’à constituer un groupe de villes hiérarchisé. En complément de ces propos, le cinquième diagramme esquisse un ensemble de six cités-jardins gravitant autour d’une cité centrale de 58 000 habitants selon un schéma rayonnant maillé par des grandes routes et des voies ferrées. Au travers de cet ultime diagramme Howard ouvre la porte à une véritable recolonisation de la campagne anglaise par un réseau de villes nouvelles à croissance limitée[15]. Mais il ne s’agit pas là d’une simple mise en perspective comme en témoigne le troisième diagramme qui dès le premier chapitre installe la cité-jardin de base au centre d’un territoire de forme annulaire qui correspond au schéma rayonnant décrit par le cinquième diagramme. Cette mise en système par duplication doit être considérée comme un principe de base qui participe du contrôle de la croissance et de la densité d’une cité-jardin type, au même titre que son organisation telle que la décrivent plus précisément le troisième et le quatrième diagramme.
À l’échelle d’une unité de base du système, le troisième diagramme met en scène la cité-jardin comme une ville circulaire composée de plusieurs anneaux, entourée d’une couronne rurale à dominante agricole, et desservie tout à la fois par une étoile routière à six branches qui définit son centre, et une boucle ferrée qui la ceinture au plus près. Ce premier schéma est précisé par le quatrième diagramme qui détaille un des six secteurs découpés par l’étoile routière. L’élément majeur prend la forme d’une voie circulaire de près de 100 mètres de large qui peut se lire comme un parkway desservant une ville linéaire annulaire, avec au centre de cet anneau une galerie commerciale encerclant un parc regroupant les principaux équipements institutionnels, et à sa périphérie, une couronne d’établissements industriels ainsi qu’une ceinture maraîchère desservies par une double boucle de voies ferrées. Howard prend ainsi le contrepied de la composition de la plupart des villes européennes contemporaines en instaurant au centre de son prototype un vide paysagé en guise de lieu dédié aux échanges, et à sa périphérie une zone productive qui joue le rôle d’une véritable enceinte. L’inversion se lit également dans la dénomination des voies puisque les voies circulaires prennent le nom d’avenue et les voies radiales, celui de boulevard. Si l’argument majeur de Howard demeure le principe d’une maîtrise foncière collective, sa conception spatiale de la cité-jardin entend manifestement renforcer ce principe par l’aménagement d’une coupure radicale entre ville et campagne qui appelle de nouvelles références.
Unwin, garden city et Town planning in practice….
Le modèle de ville nouvelle promu par Howard ne pouvait manquer d’interpeler les tenants du mouvement Arts and Crafts, et tout particulièrement des maîtres d’œuvres comme Barry Parker et Raymond Unwin qui travaillent alors ensemble depuis plusieurs années au développement d’un l’habitat individuel accessible à la classe ouvrière anglaise[16]. À Letchworth, l’emprise urbanisable est déployée entre deux routes existantes reliant les bourgs voisins pour former un parallélépipède d’environ 500 hectares qui offre la particularité d’être coupé en deux par la voie ferrée Londres Cambridge. La gare s’impose ainsi d’emblée comme le point central d’une composition d’ensemble qui s’appuie sur deux axes parallèles dont l’un relie les deux rives de la voie ferrée et découpe la future ville en secteurs, tandis que l’autre commande son centre installé dans le secteur sud sur la base d’un tracé rayonnant, étonnamment inspiré du plan de Christopher Wren pour la reconstruction de Londres. La plupart des ingrédients de la cité jardin sont là, mais décalés, redistribués ou reformatés à l’aune du site. Le premier plan daté de 1904 suggère même l’idée d’une voie périphérique qui unifierait et délimiterait le tout face à la ceinture agricole. Elle disparaît cependant des premiers états des lieux réalisés à partir de 1906, qui voient le centre monumental délaissé au profit des alignements de l’axe de liaison, puis de toute une série de variations sur le thème du close. À l’heure des premières visites, Letchworth devient ainsi le laboratoire d’un urbanisme dédié à la maison individuelle dans la continuité des expérimentations menées en premier lieu à New Earswirck et à Hampstead, délivrant au passage une nouvelle vision de la limite.
Au delà de l’actualité du TPA, Town planning in practice… rend compte d’une expérience qui s’est ouverte par nécessité aux transformations des villes en général. Refusant tout dogmatisme, Unwin y défend le double préalable de l’enquête et de l’analyse in situ pour justifier une approche thématique de la problématique du plan qu’il ouvre justement par la question des limites[17]. S’interrogeant sur la possibilité même de limiter l’extension d’une ville, il souligne néanmoins l’intérêt qu’il y aurait d’aménager de larges bandes séparatives de parcs, de terrains de jeux, ou même de terrains de culture, en un mot, des ceintures d’espaces libres, entre les différentes composantes d’une ville, jusqu’à créer […] une ligne jusqu’à laquelle la ville et la campagne pourraient chacune de son côté s’étendre et s’arrêter nettement. Si de manière prémonitoire, il voit dans ces espaces libres une réserve pour la faune et la flore, il estime cependant que, dans les villes modernes, les routes sont moins importantes comme moyens d’accès que les voies ferrées, voyant encore dans les gares, les nouvelles portes de la cité. S’il fait une brève allusion aux larges boulevards, avenues et ceintures de promenades, nés du déclassement d’enceintes intérieures, le mot boulevard et ses synonymes européens sont totalement absents du reste de l’ouvrage. Par ailleurs, force est de constater qu’Unwin passe rapidement sur la question des flux routiers, rapidement réduite à une affaire de radiales et de carrefours inspirée par les travaux de Hénard.
Retour sur Londres, à la TPC
Chez Howard comme chez Unwin, la situation londonienne n’est jamais très loin, mais sans jamais être abordée de front. S’il revient dessus dans l’ultime chapitre d son ouvrage, Howard peine à dessiner un avenir à sa ville natale dont il espère la décroissance. Loin d’extrapoler son cinquième diagramme à l’échelle d’un Greater London, il se borne à signaler qu’il faudra tout reprendre, tout reconstruire[18]. De son côté, Town Planning in practice… prend rarement Londres en exemple, et Unwin ne semble pas encore envisager la création de villes nouvelles comme une solution pour maîtriser la croissance londonienne. C’est d’ailleurs Hampstead qu’il présente et qu’il fait visiter à l’occasion de la TPC, constatant au passage que Letchworth se trouve à ses yeux dans une périphérie trop lointaine, sans en dire davantage[19]. S’il est alors question de l’avenir de Londres, ce n’est donc pas le fait des principaux tenants de la cité jardin, mais d’acteurs moins connus, directement impliqués dans la gestion de la capitale anglaise, à l’image d’Arthur Crow[20], District Surveyor de Whitechapel, voire d’inconnus comme George Pepler[21].
Les interventions de Crow et Pepler partagent une même dénonciation des conditions de circulation dans l’agglomération londonienne et la même conviction que ce problème doit être résolu dans le cadre d’un territoire élargi en l’occurrence à un rayon de plus de 20 kilomètres du centre de Londres. Pour sa part, Crow envisage une double action d’aménagement et d’extension avec le percement d’une dizaine de radiales de plus de 30 mètres de large, et la création, à une vingtaine de kilomètres du centre, d’une couronne d’une dizaine de villes nouvelles qualifiées de city of health. Le schéma n’est pas sans rappeler le cinquième diagramme de Howard, à ceci près que ces villes, reliées au centre par des trains rapides accueilleraient jusqu’à 500 000 habitants sur 10 000 hectares, contre 32 000 sur 400 pour le modèle howardien. Pepler quant à lui dénonce la quasi-inexistence de ring roads, et reprend à son compte un projet de grand boulevard de ceinture proposé quelques mois plus tôt dans Architectural Review[22]. Située, elle aussi, à une vingtaine de kilomètres du centre de Londres, au sein d’une couronne agricole épargnée par l’urbanisation, cette infrastructure d’une centaine de mètres de large, longée par des parcs et des zones de nature, juxtapose plusieurs modes de transports. Aux yeux de Pepler, elle permettait de détourner du centre de Londres un trafic de transit en pleine croissance, tout en desservant aussi bien des usines et des faubourgs-jardins que des lieux de commerce. Une perspective que salue sur le champ un représentant de l’association des cités-jardins qui voit là l’occasion d’accélérer le déménagement des lieux de production du centre de Londres vers sa périphérie[23]. Ainsi, l’idée de cité-jardin participe t-elle dès ce moment à l’élaboration d’une nouvelle vision des franges londoniennes dans le cadre d’une vision d’un Greater London directement alimenté par l’expérience du Groß Berlin citée à plusieurs reprises.
De Vienne à Berlin : à la recherche de la Großstadt
Alors que Howard avait puisé une part de ses idées dans le creuset américain des années 1870, vingt ans plus tard, Unwin et les promoteurs du TPA se sont tournés spontanément vers l’Allemagne qui s’impose alors comme la référence en matière d’extension urbaine. Il est vrai qu’aux textes de loi et aux manuels, aux essais et aux débats de la première heure, sont venus s’ajouter des concours et une exposition, une revue dédiée et un enseignement spécialisé, mais aussi, et surtout, des dizaines de réalisations (Dethier, 1994). Fort de cet incontestable savoir-faire, ses principaux protagonistes ambitionnent désormais d’investir Berlin et de faire de la capitale allemande le modèle de la grande ville moderne. Un concours international est envisagé dès 1905, puis une exposition dont la conception est confiée à un jeune économiste féru d’architecture, Werner Hegemann. Ses séjours aux États-Unis vont confirmer l’émergence de nouveaux liens entre les expériences européennes et la vision américaine. Cependant, si la deuxième édition de l’exposition à Düsseldorf fin 1911 s’ouvre sur le plan de Chicago, un an plus tôt, à Berlin même, c’était une grande maquette de Vienne[24] qui servait d’introduction aux résultats du concours, comme un hommage à la capitale voisine qui dès 1893 avait la première posée la question de la Großstadt et de ses limites au travers d’un concours remporté conjointement par Joseph Stübben et Otto Wagner.
L’antécédent de Vienne
En 1892, Vienne entreprend d’annexer une vaste banlieue industrielle très dispersée qu’elle a contribué à créer par le rejet de plus en plus lointain de ses activités les plus polluantes. L’opération triple sa surface qui avoisine désormais les 180 kilomètres-carrés, mais n’augmente que de moitié sa population qui atteint désormais 1,3 millions d’habitants. Un concours est lancé dès l’année suivante pour l’établissement d’un plan régulateur dont les objectifs sont des plus ambitieux puisqu’il s’agit pour les concurrents aussi bien d’articuler les différentes composantes de la nouvelle agglomération, d’intégrer le projet d’un réseau ferroviaire de transport urbain, d’établir une réglementation pour les constructions nouvelles, que d’envisager la préservation de la forêt voisine. En un mot, il s’agit de dégager une vision d’ensemble de ce vaste territoire. La consultation, qui reste une affaire germanique, consacre parmi une quinzaine de réponses, deux interprétations différentes d’un même parti radioconcentrique[25].
Tandis que Stübben répond sans surprise aux recommandations paysagères de l’argumentaire du concours, directement inspirées par Camillo Sitte, Wagner s’en démarque volontairement pour affirmer un point de vue opposé, réinterprétant le carroyage des lotissements caractérisant la périphérie viennoise, en se référant explicitement à la géométrie des paysages urbains parisiens[26]. À ses yeux, le grand avantage que possède Vienne sur d’autres capitales européennes est d’avoir transformé à temps sa deuxième couronne fortifiée en une voie de ceinture. Il propose pour sa part de constituer, au delà de cette limite héritée, deux nouvelles voies du même type qu’il calibre à 80 mètres de large. Il ajoute même dans son mémoire même que la ville devrait mettre à l’étude une nouvelle couronne de ce genre tous les 50 ans[27].
Wagner reviendra sur cette expérience à l’occasion d’une conférence donnée à New York en 1910[28] dont le texte et les illustrations témoignent de la radicalisation de sa vision de la Großstadt[29]. Fidèle au schéma radioconcentrique, il imagine dans un rayon de 14 kilomètres un large maillage de voies radiales et circulaires, dites cette fois voies zonales, qui distribue, à la manière de grandes plaques urbaines, des arrondissements de 100 000 à 150 000 habitants basés sur un damier d’îlots ponctué de placettes et d’axes monumentaux commandant de grands équipements. Imaginant cette grande ville illimitée, par essence, il se déclare hostile à la constitution de toute barrière, de tout « boulevard périphérique », de toute ceinture, agricole ou forestière. Il s’oppose ainsi clairement au projet de ceinture verte proposée par l’un de ses concurrents malheureux lors du concours, l’architecte viennois Eugen Fassbender[30], sous la forme d’une couronne de 750 mètres de large située en lisière de la forêt viennoise. Cependant l’idée a ses partisans de longue date, et en 1905, Vienne se signale à nouveau en adoptant la première en Europe, la mise en place d’une ceinture verte encore qui associe la protection de la forêt située au Nord-Ouest de Vienne et d’une zone agricole limitrophe de 6 000 ha (Lohrberg, 2001).
Berlin, l’émergence du concours et de l’exposition
Tout comme Vienne, Berlin se trouve confrontée à une périphérie industrielle en plein développement. Mais avec bientôt 2 millions d’habitants au début des années 1900 elle devient alors la ville la plus densément peuplée d’Europe sans pour autant afficher le visage d’une grande capitale, alors même que le savoir-faire allemand en matière d’extension urbaine s’affirme sur la scène internationale. Pour résoudre cette anomalie, les deux principales associations allemandes rassemblant architectes et ingénieurs unissent leurs efforts pour convaincre les autorités berlinoises de lancer un concours en vue de jeter les bases d’un Grand Berlin et donc de réfléchir à la forme et aux limites de la capitale (Bodenschatz, 2010, Jacquand 2013). Initiée en 1905, leur action se concrétise dès 1907 par la publication d’un manifeste qui aborde le programme de la Großstadt en termes de démographie et d’économie, de réseaux de transport, mais aussi de formes urbaines. Dans un passage consacré aux trames vertes, Theodor Goecke, le rédacteur en chef de la revue Der Städtebau, cite en exemple la toute récente ceinture verte de Vienne[31] ainsi que les systèmes de parcs américains, et notamment celui de Boston dont la découverte va enthousiasmer Hegemann l’année suivante[32]. Sur le terrain, le lancement en 1908 d’un concours pour une cité-jardin à Frohnau[33], à une quinzaine de kilomètres au Nord du centre de Berlin, témoigne à son tour tout à la fois de l’ampleur du territoire concerné et de l’élargissement des références qui accompagne les préparatifs de la consultation engagée.
De fait, à l’image du plan de Chicago, l’ambition s’avère immense puisque le périmètre envisagé se déploie entre 25 et 30 kilomètres autour de la ville centre sur près de 2 000 kilomètres-carrés. Une nouvelle cartographie détaillée se révèle nécessaire, et ce d’autant plus que le programme du concours sollicite des concurrents une réflexion à de multiples échelles, de celle du territoire pour l’amélioration des réseaux de transports, à celle du quartier pour la conception de projets urbains, au centre comme en périphérie, et plus particulièrement d’opérations d’habitat déclinant de nouvelles typologies. L’élaboration de ce fond de plan calé au 1/10 000e retarde d’un an le lancement du concours qui est rendu en décembre 1909. D’une trentaine de réponses, essentiellement d’origine germanique, le jury va retenir quatre projets, à commencer par les deux premiers classés ex æquo, celui de Hermann Jansen qui a contribué à établir le fond de plan du concours, et celui de Joseph Brix et Félix Genzmer[34] associés à une compagnie de chemin de fer, suivis par celui de l’équipe composé par l’économiste Rudolf Eberstadt, l’architecte Bruno Mörhing et l’ingénieur Richard Petersen, et par celui de l’architecte Bruno Schmitz associé au bureau d’études Havestag et Contag[35]. Derrière la question première des réseaux, alimentée par cette présence nouvelle des ingénieurs au sein même des équipes, c’est le rapport à la nature de cette ville territoriale qui s’impose dans les débats.
Les résultats du concours
À l’exposition, de spectaculaires vues à vol d’oiseau signés par l’architecte Bruno Schmitz captent dans un premier temps l’attention des visiteurs en leur offrant au travers d’une série d’espaces publics centraux une vision monumentale de la grande ville que certains commentateurs jugent d’emblée démesurée[36]. Mais au bout du compte, ce sont deux modestes schémas, produits par l’équipe Eberstatd, Mörhing, Petersen, qui condensent le mieux tous les apports de cette consultation. Sur la base d’une figure annulaire, ce trio oppose à une vision traditionnelle de la croissance des villes, par limites et couronnes successives, la vision d’une croissance urbaine radioconcentrique portée par des radiales. Articulées à des voies de transports rapides, ces radiales prennent la forme de coulées vertes qui pénètrent jusqu’au cœur de la ville et fragmentent l’extension urbaine en secteurs. L’argumentaire déployé dans le mémoire (Eberstadt, 2010) s’appuie tout à la fois sur l’observation d’évolutions générales comme le développement des banlieues autour des lignes de chemin de fer, mais aussi sur l’analyse d’exemples singuliers comme la ville balnéaire de Wiesbaden. Cependant, c’est Jansen, l’un des deux lauréats, qui livre sans doute l’interprétation la plus explicite et la plus complète de cette mise en tension entre ces relations centre-périphérie, et les logiques de croissance et de contournement (Borsi, 2015)[37].
Dans un contexte qui donne encore la priorité au réseau ferré, Jansen se borne à doubler l’étoile routière existante par des lignes de tramways, en revanche, il se distingue en proposant la création à une douzaine de kilomètres du centre d’un second chemin de fer de ceinture pour articuler entre elles les lignes radiales, mais aussi les banlieues les plus éloignées et donc les plus dispersées. Cette ultime ceinture se situe au delà de la principale originalité du projet que constitue la formation de deux ceintures vertes, forestières et agricoles, d’une largeur variant de moins de 100 mètres à près de 2 kilomètres, situées à respectivement à 6/7 et à 10/12 kilomètres du centre. Cependant, Jansen ne se limite pas à ce dispositif annulaire. Il le relie au cœur de la ville par de multiples ramifications interstitielles qu’il détaille au 1/10 000e sur les entrées Sud et Nord, et plus encore dans les deux projets de quartiers d’habitation qu’il donne pour le secteur de Tempelhof et la commune périphérique de Radow. La trame ainsi déclinée sert de fil conducteur et de lien entre deux échantillons d’un gradient de situation et de densité du centre vers la périphérie. À un ensemble collectif dense situé en frange du centre, Jansen oppose ainsi un ensemble mixte de moyenne densité, situé en troisième couronne à proximité de la ceinture verte extérieure, qui peut se lire comme une cité-jardin satellitaire d’une Großstadt aux contours fragmentés.
À l’issue de ce panorama sélectif qui balaye une décennie de réflexions théoriques et de projets, mais aussi de réalisations, se dégage d’abord une impression de diversité qu’incarne bien l’opposition radicale entre un Howard qui vise à déconstruire la métropole londonienne par le biais d’entités urbaines isolées strictement délimitées et un Wagner qui prône une croissance illimitée de la métropole viennoise par le biais d’anneaux successifs composés d’unités urbaines juxtaposées. Entre ces deux visions extrêmes, se dessine au fil du temps une évolution des modèles de pensée sur la forme générale de la ville qui part d’un modèle compact post-haussmannien au tissu continu, illustré par le premier projet de Jaussely pour Barcelone ou celui de Burnham pour Chicago, et qui tend vers un modèle fragmenté au tissu discontinu – que l’on pourrait qualifier de post-howardien, en ce qu’il découle des premières interprétations du concept de cité-jardin -, illustré par la plupart des projets en lice à Berlin, mais aussi dans un tout autre registre par celui des Griffin pour Canberra. Dans le cas de Barcelone et de Berlin, l’extension du périmètre de réflexion, qui se traduit par l’inclusion de territoires essentiellement ruraux, impose de penser le rapport entre le front urbain et les domaines agricole, forestier ou naturel. De ce point de vue, le second projet de Jaussely et celui de Jansen sont particulièrement représentatifs de la mise en place d’une logique de gradient de densité du centre vers la périphérie. Du côté des figures, force est de constater que le recours à des voies annulaires n’est pas systématique, de même que l’emploi du terme de boulevard. À la grand avenue imaginée par Howard, répond le grand circuit promu par Burnham ainsi que l’étonnante infrastructure multimodale annulaire proposée – ring road – par Pepler pour Londres qui n’a pas d’équivalent par ailleurs. En revanche tous les protagonistes mettent en avant l’importance des radiales en s’appuyant de manière plus ou moins explicite sur les travaux de Hénard. Détournée d’emblée par Unwin lui-même, la cité-jardin, quant à elle, ne s’impose dans l’immédiat qu’à Londres et à Berlin, soit sous la forme de quartiers résidentiels de maisons comme dans les projets berlinois, soit sous la forme de villes nouvelles périphériques, les city health de Crow. Enfin pour ce qui des rapports avec les zones de nature et de culture, le principe des systèmes de parcs trouve des échos à Vienne et sur la scène berlinoise sous la forme de ceintures vertes et/ou de coulées vertes par Jansen et par l’équipe Eberstadt, Möhring, Petersen qui esquisse l’idée de trame verte également suggérée par Unwin et conforte la représentation d’une ville fragmentée. Une vision que synthétise la perspective à vol d’oiseau donnée par un des concurrents du concours de Berlin, l’architecte Albert Gessner[38].
Références
[1] Voir Lucan, 2009, chapitre 11, « La fin du système de l’École des beaux-arts » pp. 191-207.
[2] Jaussely rejoint la villa Médicis en janvier 1904. S’il n’y rencontre pas Tony Garnier qui est déjà reparti, mais Henri Prost, les échos du séjour de Garnier ont pu jouer un rôle dans le choix de participer à ce concours.
[3] Dans Nice, capitale d’hiver, Robert De Souza expose de manière synthétique la méthode que s’est forgée Jaussely pour élaborer le plan de Barcelone à partir du mémoire de 1907.
[4] Le rendu du concours est consultable sur Wikipedia dans le cadre d’une notice en espagnol intitulée « Plan Jaussely ».
[5] Voir De Souza, 1913, p 411, et Gondouin, 2004, vol. 2, p. 64.
[6] Ce schéma qui s’appuie sur un étagement très méditerranéen n’est sans évoquer la Cité industrielle de Garnier.
[7] De Souza, 1913, pp. 416-417.
[8] Si Burnham n’est alors pas encore allé en Europe, la plupart de ses collaborateurs, et son associé Edward H. Bennett, ont été formés à Paris. Leur culture, et notamment les souvenirs de l’exposition de 1900, vont fortement influencer la mise au point du projet.
[9] Voir Burhnam, 1909, le chapitre VI consacré à la voirie, et plus particulièrement les pages 92-96.
[10] Schaffer, « The Plan of Chicago : published, unplublished, and the treachery of images », in Bodenschatz, 2010, pp 96-99
[11] National Archives of Australia, NAA: A1818,12
[12] Peut-être faut-il voir là un effet des débats suscités par la multiplication des îlots triangulaires que supposait les radiales projetées par Burnham.
[13] Voir Unwin, 1909, 1981 [1922].
[14] p. 22 et 128, dans l’édition de 1902, et p. 42, 44 et 178, dans l’édition française de 1998.
[15] Chambers, « The garden and the city. Dispositifs architecturaux et progrès social dans le modèle urbain d’Ebenezer Howard », in Baty-Tornikian, 2001, pp 13-25.
[16] Miller, « De Letchworth aux cités-jardins anglaises, 1904-1946 », et Jackson, « Sir Raymond Unwin et le mouvement des cités-jardins, 1902-1940 », in Baty-Tornikian, 2001, pp. 35-48 et 49-57.
[17] Unwin, 1981, chapitre V « Du moyen d’entourer les villes modernes et les entrées des villes » pp. 137-151.
[18] Howard, 1998, p. 197.
[19] Unwin Raymond, »The City development plan », in TPC, 1911, pp. 250.
[20] Arthur Crow (1860-1937), membre fondateur du Royal Town Planning Institute. Crow, « Town planning in relation to old and congested areas, with special reference to London », », in TPC, 1911, pp. 407-426.
[21] George Pepler (1882-1959) deviendra membre de la Garden Cities Association, puis président du Royal Town Planning Institute en 1919, et responsable du Town and Country Planning. Pepler, « Greater London », in TPC, 1911, pp. 611-620.
[22] TPC, 1911, p. 627.
[23] TPC, 1911, p. 623.
[24] Hegemann, 1913, pp. 248-249, et Bodenschatz, 2010, p. 20.
[25] Hagen, 2015, p. 51.
[26] Graf 1994, p. 94.
[27] Ibid., p. 96.
[28] Conférence donnée à New York, le 18 mars 1910, à l’occasion de l’International Congress of Municipal Arts.
[29] Graf, 1994, pp. 640-646, et Wagner, 1980, pp 83-95.
[30] Eugen Fassbender (1854-1923).
[31] Jaquand, 2013, p 113. Voir également Goecke, « Der Wald- und Wiesengürtel von Wien und Seine bedeutung für den Städtebau », in Der Städtebau, 1906, vol. 3.
[32] Jaquand, 2009, p. 286.
[33] Bodenschatz, « Gartenstadt Frohnau », in Bodenschatz, 2010, pp 180-181
[34] Bodenschatz, « Joseph Brix und Felix Genzmer, Grunflachenplan, Beitrag zum Wettbewerb Groß-Berlin 1908/1910 », in Bodenschatz, 2010, pp 198-199. Voir également, pp. 138-139, et 182-183.
[35] Nägelke, « Havestadt & Contag, Schmitz und Blum, Monumentalisierung des Stadtzentrums Beitrag zum Wettbewerb Groß-Berlin 1908/1910, in Bodenschatz, 2010, pp. 134-135.
[36] « Architektonisches von der allgemeinen städtebau-ausstellung zu Berlin », in Berliner Architekturwelt, juillet 1910, pp. 123-162.
[37] Nägelke, « Hermann Jansen, Bebauung des Tempelhofer Feldes, Beitrag zum Wettbewerb Groß-Berlin 1908/1910 », in Bodenschatz, 2010, pp. 164-165. Voir également, pp. 110-111, et 186-187.
[38] Bodenschatz, « Albert Gessner, vision einer urbanen Stadtregion : Von der Südbanhofstrasse zum Mügelsee Beitrag für den Wettbewerb Groß-Berlin 1908-1910 », in Bodenschatz, 2010, pp. 114-115.
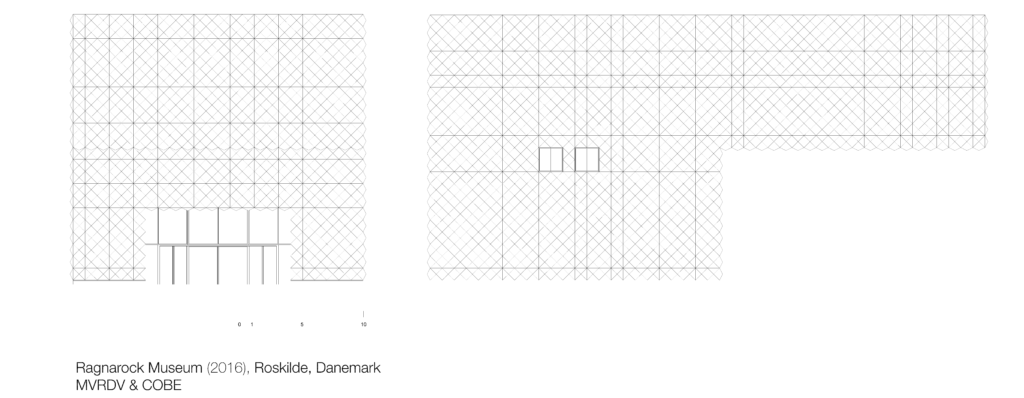
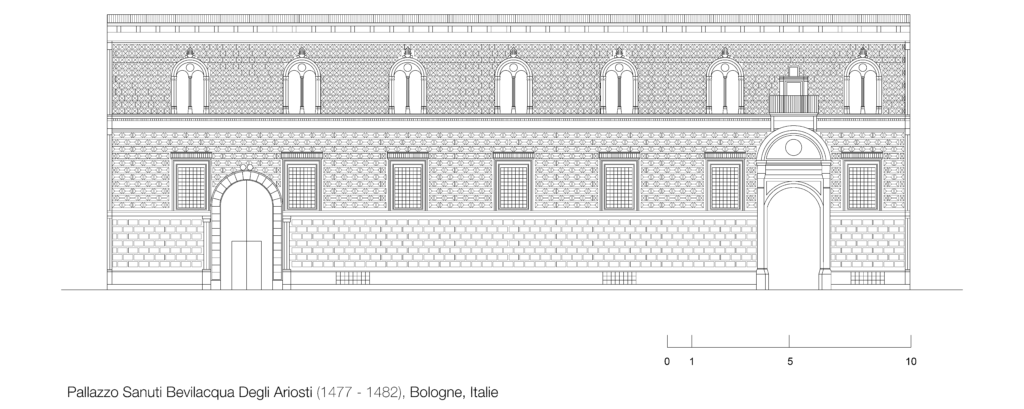

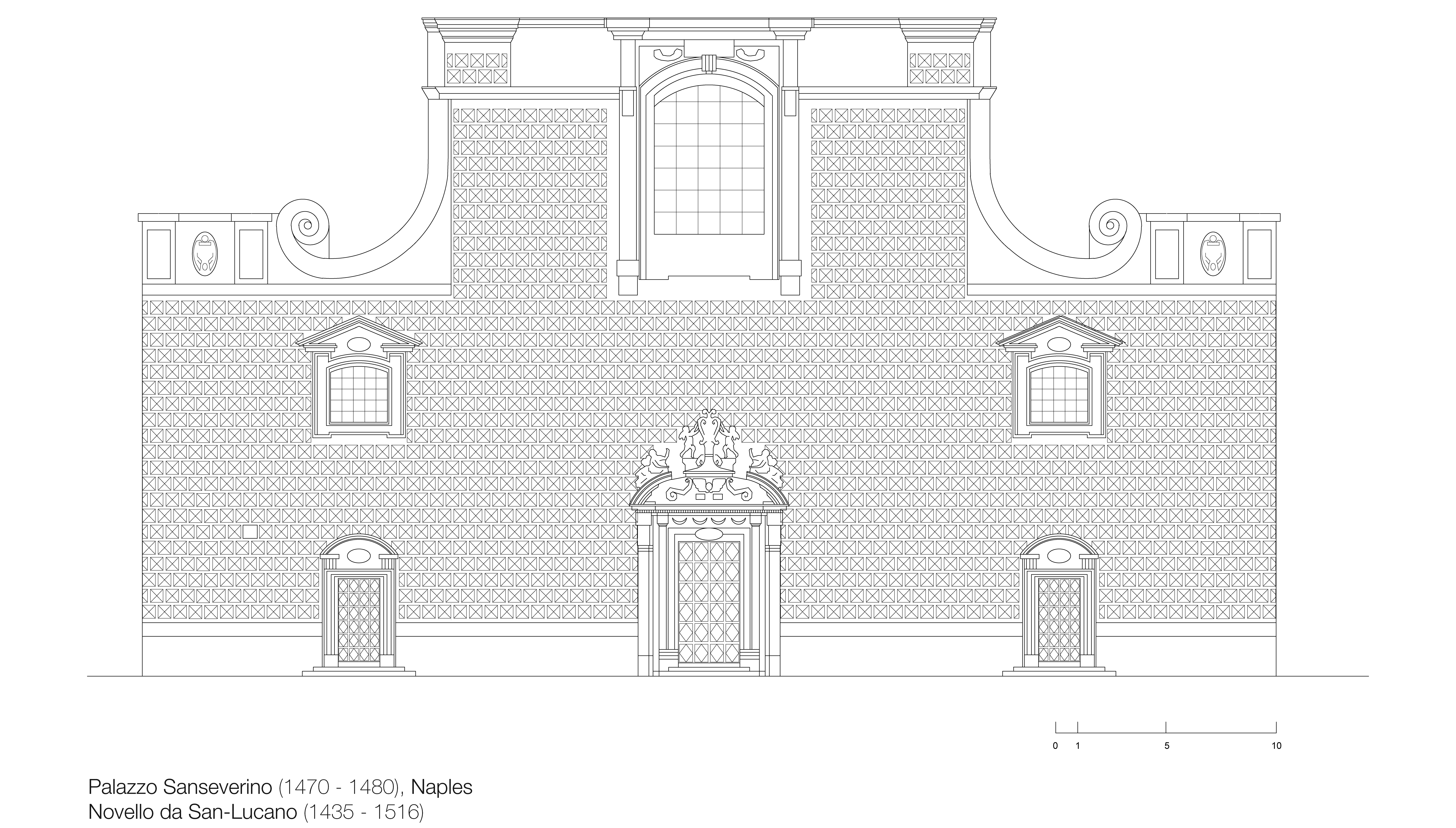
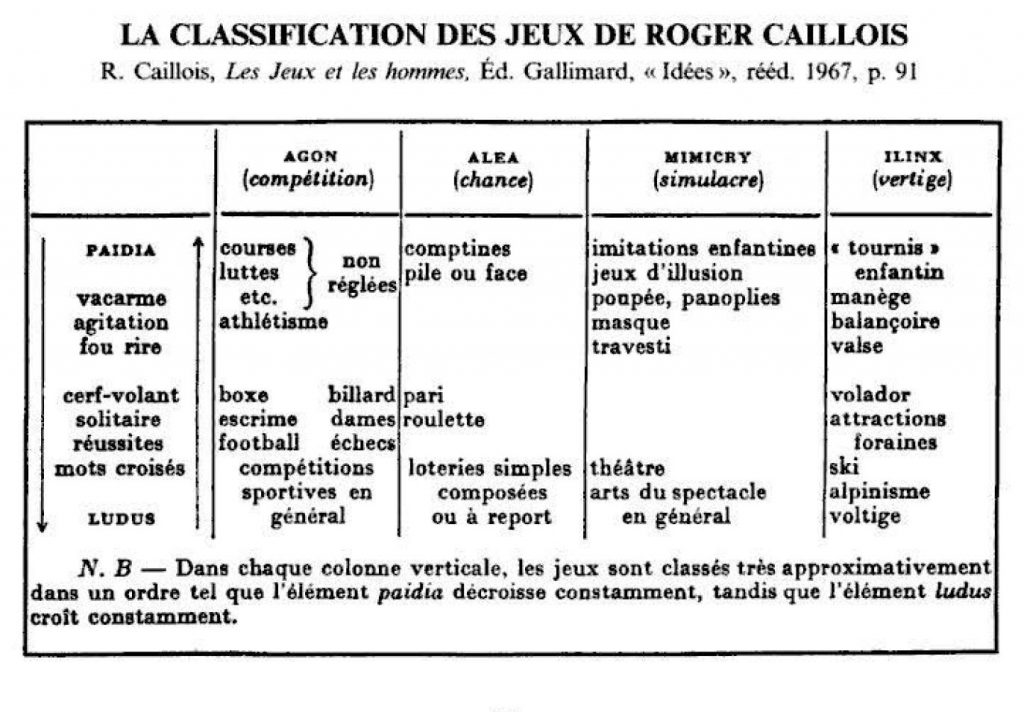 Tableau de classification des jeux de Roger Caillois, repris par Colas Duflo dans son ouvrage « Jouer et philosopher » (1997b) à la page 21.
Tableau de classification des jeux de Roger Caillois, repris par Colas Duflo dans son ouvrage « Jouer et philosopher » (1997b) à la page 21.