"Milieu et architecture", Recension
L’ouvrage :
Yann NUSSAUME, Milieu et architecture. Entretiens avec Augustin Berque, Philippe Madec et Antoine Picon, Collection « Architectures contemporaines » (Richard Klein), éditions Hermann, Paris, 2021.
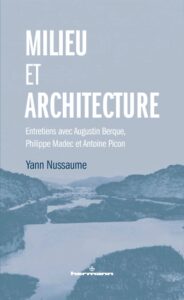
L’auteur :
Yann NUSSAUME est architecte, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La-Villette. Il est co-directeur de l’unité de recherche « Architecture, milieu, paysage », et a écrit et co-dirigé la publication de nombreux ouvrages sur les questions architecturales et paysagères.
Compte-rendu :
Cet ouvrage, composé de trois entretiens avec des personnalités marquantes des domaines architectural et paysager actuels, a pour premier objectif « d’aider les personnes intéressées par les rapports entre les milieux et l’architecture à se construire un cadre théorique et des outils de réflexion »[1]. Effectivement, Augustin Berque, Antoine Picon et Philippe Madec nous présentent plusieurs situations qui permettent de mobiliser les notions d’écoumène, de mésologie, de vernaculaire, de nature, de durabilité et de frugalité, rendant ainsi compte de l’existence de liens concrets entre l’architecture et son contexte. Depuis leurs cadres disciplinaires respectifs - la géographie, la civilisation orientale et le paysage pour Augustin Berque ; l’histoire de l’aménagement et de l’architecture pour Antoine Picon ; et l’architecture contemporaine et ses enjeux éthiques et écologiques pour Philippe Madec -, ils explicitent les multiples relations qui se nouent entre l’acte d’aménager et le milieu dans lequel il se réalise. Voici quelques arguments à travers lesquels chacun de ces penseurs va nous conduire à une perception enrichie de notre environnement, première amorce d’un changement de perspective possible.
Augustin Berque : l’expérience des lieux pour dépasser le dualisme moderne
Augustin Berque développe depuis toujours la quête d’un dépassement possible du dualisme moderne à travers la proposition d’une approche « mésologique » (la science des milieux) de l’écoumène[2]. Encore présente dans certaines civilisations orientales, mais également au cœur de l’approche paysagère, le couplage des choses à leur représentation constitue ici une véritable opportunité de percevoir ce dépassement, dans la mesure où la représentation permet de conserver une continuité entre la chose perçue concrètement et la chose conçue par le biais de la pensée. Le concept de « Fudosei » rend alors précisément compte de ce « moment structurel de l’existence humaine »[3] qui se réalise dans le temps particulier de l’expérience des lieux. A cette occasion, nous développons tous une sensibilité individuelle à notre environnement, mais la question se compléxifie énormément quand il s’agit de passer à la dimension collective. Comment nos logiques d’articulation éco-techno-symboliques pourraient-elles aujourd'hui se structurer différemment pour organiser une meilleure appréhension collective des milieux contemporains, demande alors Augustin Berque ?
Les rapports des humains à l’étendue terrestre ne pourront jamais être réduits à des dimensions mesurables puisqu’ils sont avant tout sensibles. La perception d’un lieu découle essentiellement des pratiques que l’on y développe, rappelle encore Augustin Berque, et les milieux s’éprouvent suivant le principe d’une « trajection », c’est-à-dire suivant une interprétation sensible du lieu qui se réalise dans le cadre même de l’interaction concrète avec lui. La relation établie avec un environnement s’exprime alors ensuite suivant différentes métaphores qui dépendent de tendances développées à chaque époque. Depuis « l’éther antique », qui désignait la matière intermédiaire agissant entre deux corps, en passant par les déterminations environnementalistes des géographes du XIXème, puis aux explications plus sociétales des géographes culturalistes (Paul Vidal de la Blache), ou encore par la phénoménologie (Edmund Husserl) et la remobilisation du corps sensible, et enfin, par la quête du vivant (Georges Canguilhem), les motivations restent donc extrêmement mutliples.
Et si la modernité a effectivement inventé un sujet individuel tout puissant, nous dit encore Augustin Berque, la condition « transmoderne »[4] cherche aujourd'hui de son coté d’autres termes pour redéfinir le sujet, en faisant notamment appel à la dimension d’une « cosmicité » élémentaire, en relation avec un usage du sol plus acceptable et mieux socialement partagé. Cette posture n’implique d’ailleurs pas de renier les avancées techniques et sociales réalisées par la modernité, mais il s’agit d’y réintroduire certaines mesures qui en ont été éliminées alors qu’elles sont aujourd'hui indispensables pour établir une relation concrète et réciproque avec notre environnement.
Antoine Picon : une histoire de l’architecture qui intègre les exigences de son milieu
Antoine Picon a de son côté cherché à détecter la prise en compte du milieu dans les écrits historiques d’architecture. Il conclut alors que cette attention se manifeste principalement dans les textes suivant trois aspects : à travers la pensée d’un auteur, soit qui est conscient d’appartenir à un milieu, ou bien qui réalise la recension des influences concrètes d’un milieu sur les modes de vie, ou bien encore, qui développe une approche théorique du milieu.
Il faut rappeler qu’en architecture, après l’expérience des Grands ensembles, la notion de « contexte » a été largement remise en avant, jusqu’à parfois en faire un instrument de pure provocation, comme chez Rem Koolhaas et son « Fuck the context »[5]. Effectivement, la vocation de l’architecte n’est-elle pas contradictoire par nature ? Car il lui faut à la fois prendre en compte les contraintes imposées par un milieu (sol, climat, eau, etc.), tout en cherchant à produire un établissement humain qui s’affranchisse de ces conditions initiales pour se constituer pleinement en un espace humain. Toute l’architecture a bien été fondée sur le principe de la satisfaction première des exigences humaines. Les formes produites pouvaient par ailleurs parfois s’inspirer des formes offertes par la nature, dans la mesure où ce goût correspondait aux attentes esthétiques du moment dans la civilisation considérée.
A travers l’identification de quatre périodes, Antoine Picon rend donc compte des enjeux architecturaux dominants successifs. La période antique est notamment caractérisée par une grande diversité expressive qui correspond à la variété des attentes culturelles. Puis, à la Renaissance, l’architecture devient une activité plus intellectuelle, qui s’énonce à travers des traités, et qui élabore un ensemble de règles et de codes. Au XVIIIème siècle, alors que l’Occident découvre le reste du monde, il renonce dans le même temps à un certain nombre de principes universels tout en incluant des penchants exotiques. Puis, à partir du XIXème siècle, la notion d’utilité va commencer à dominer dans un contexte de rationalisation de la production, et la nature va également faire son apparition dans le domaine de la conception urbaine à travers les préoccupations des hygiénistes. La période d’après-guerre va ensuite marquer une nouvelle rupture en introduisant une architecture industrielle et systématique qui déclenchera par la suite une vive réaction d’opposition. L’architecture moderne sera également largement critiquée, notamment par le « régionalisme critique » proposé par Kenneth Frampton (1983), qui remet en valeur l’architecture traditionnelle et locale, toujours réalisée en forte relation avec son milieu.
Relativement à ces héritages, les attitudes des architectes contemporains restent finalement aujourd'hui très disparates, remarque Antoine Picon. La montée des enjeux environnementaux à partir des années 1990, a effectivement introduit de nouvelles exigences dans la réalisation architecturale, qui passe notamment par les notions de porosité et de perméabilité. La ville est également désormais considérée comme un « paysage urbain », et l’architecture est envisagée comme le résultat d’un processus dont il s’agit de mieux comprendre (et de maîtriser) les différentes phases et facteurs de réussite. Antoine Picon rappelle à ce propos que, dans cette nouvelle perspective, l’emboitement des échelles et la conception participative sont appelées à jouer des rôles centraux.
Philippe Madec : la frugalité comme éthique architecturale
Dès sa sortie de l’école d’architecture, en 1970, Philippe Madec s’est demandé comment faire le lien entre ce qu’il avait appris de l’architecture moderniste et son héritage vernaculaire breton. Il a alors eu besoin de distinguer la modernité envisagée comme une « expérience ardente et permanente du monde », du modernisme, qu’il a résumé à « une conception machiniste de l’établissement humain »[6] simplificatrice et uniformisante. Dans cette perspective, le régionalisme pouvait rester une solution envisageable et pertinente. Et sans écarter les avancées modernes, il redevenait possible d’affirmer des formes d’intérêts pour la topographie, le climat, la lumière, etc. Enfin, si l’on accepte de croire que le « développement durable est le nouveau grand récit mondial »[7], il s’agit également de se donner les moyens d’intégrer ses principes à l’architecture, et cela, sans pour autant oublier de valoriser le rôle de l’architecture comme un geste humain qui questionne la relation au cosmos. En évitant de s’en tenir à un strict biomorphisme, quels pourraient alors être les mécanismes de la nature dont il serait effectivement possible de s’inspirer, se questionne encore Philippe Madec.
Il fait alors allusion au concours du Global Award for Sustanable Architecture[8], qui récompense depuis 2006 des projets vertueux ancrés dans leurs territoires, en travaillant également à partir d’un modèle coopératif. Les architecturales frugales qui y sont développées permettent d’amorcer des démarches durables sur les plans économiques, écologiques et sociétaux. Car si la première mission de l’architecture reste bien celle d’apporter des qualités à la « spatialisation des conditions de vie », comme le dit Renzo Piano, cette spatialisation doit alors intégrer à la fois une conception écoresponsable du bâti et de l’usage des matériaux, mais également une attention spécifique à ce qui est déjà là. Dans cette perspective, la prise en compte de la frugalité dans le projet architectural interroge forcément l’enseignement tel qu’il est dispensé aujourd'hui et elle introduit également la nécessité de penser à de nouvelles matières d’enseignement, telle que l’écologie, la podologie, l’hydrologie, etc., ajoute alors Philippe Madec.
En croisant la pensée d’un géographe-philosophe en quête de dépassement de la modernité à travers l’expérience concrète des lieux, d’un historien qui dresse l’inventaire des différentes manières de prendre en compte l’environnement dans le projet architectural, et d’un architecte qui expose de nouvelles manières de pratiquer le projet architectural en incluant les préoccupations environnementales, apparaissent de multiples manières de repenser l’acte de bâtir. Repartant du point de vue humain, comment est-il aujourd'hui possible de construire en intégrant une plus grande attention aux enjeux environnementaux ?
Premiers héritiers de la modernité, les architectes sont aujourd'hui placés face à des dilemmes profonds et permanents, oscillant entre la réparation d’un monde hérité du modernisme[9], tout en ayant la responsabilité d’inventer les termes d’une nouvelle architecture plus frugale, qui « ménage » son environnement. A travers cet ouvrage, Yann Nussaume nous présente alors de manière très conviviale et accessible un chemin habilement conduit pour explorer un certain nombre des réflexions actuelles nécessaires pour formuler de nouvelles propositions.
[1] Nussaume, 2021, p7.
[2] L’écoumène est défini par Augustin Berque comme l’ensemble des relations de l’humanité à l’étendue terrestre.
[3] Nussaume, 2021, p18.
[4] Rosa Maria Rodriguez Magda, La condition transmoderne, L’harmattan, 2014.
[5] Extrait de Delirious New York, Parenthèses, en 1978.
[6] Nussaume, 2021, p220-221.
[7] Nussaume, 2021, p236.
[8] Le Global Award for Sustainable Architecture ™, créé en 2006 par l'architecte et chercheur Jana Revedin, en partenariat avec la Cité de l'Architecture & du Patrimoine et les institutions membres de son comité scientifique, distingue chaque année cinq architectes qui partagent les principes du développement durable et d’une approche participative de l’architecture aux besoins des sociétés, au Nord comme au Sud de la planète. https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/global-award-sustainable-architecture
[9] Nussaume, 2021, p308.
